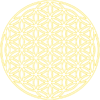BADINTER (Elizabeth) – « FAUSSE ROUTE » – édition C.JACOB, Avril 2003, Paris – 221 p.
Contenu – Résumé signalétique :
E.BADINTER, philosophe, écrivaine, auteur de l’Amour en plus, de l’un est l’autre, x y de l’identité masculine, tente dans ce livre de prendre le contre-pied d’un discours dominant risquant de dégrader un peu plus les relations homme-femme. Face à la domination masculine, certaines féministes répliquent en tentant d’instaurer un nouvel ordre moral, avec le risque de renoncer avec le séparatisme et de freiner la marche vers l’égalité notamment en cultivant une idéologie « VICTIMISTE ». E. BADINTER à accompagné le combat militant du M.L.F et s’insurge à travers ce livre contre ses dérives.
Mots clefs
Américains
Culture
Différentraliste – domination masculine – droit
Egalité – essentialiste
Féminismes
Liberté
Maternité
Nationaliste – nature
Paritaire
Séparatiste
Victimiste
Phrases clefs
P 16 : « Je souffre, donc je vaux », conclut Bruckner. Toute souffrance appelle dénonciation et réparation. La victimisation générale de la société a donc entraîné la montée en puissance des tribunaux. On ne parle plus que de pénalisation et de sanction.
P 18 : Cette démarche « victimiste1 » n’est pas dénuée d’avantage.
P 71 : La victime a toujours raison.
p 77 : La femme incarne à la fois la victime d’une société masculine et le courageux petit soldat qui répare les dégâts causés par les hommes.
P 85 : Reste impensable et impensé tout ce qui diminue la portée du concept de domination masculine et de l’image des femmes victimes.
P 88 : En vérité, la violence féminine est difficile à penser, non seulement pour des raisons militantes – la violence n’a peut-être pas de sexe -, mais parce qu’elle met en péril l’image que les femmes se font d’elles-mêmes.
P 89 : Naturellement ou culturellement, celles-ci seraient étrangères à la violence de ceux-là.
P 97 : Si on a tant de mal à concevoir l’idée d’une telle violence féminine, c’est parce qu’ « il s’agit là d’un stéréotype social, lié à l’idéalisation des femmes, qui entretient l’idée que seuls les hommes puissent commettre de tels actes. »
P 31 : « Un comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à connotation sexuelle, qui tente de porter atteinte à la dignité d’une personne, en créant une situation intimidante, hostile, dégradante, humiliante ou offensante. »
P 51 : D’un côté Elle, impuissante et opprimée ; de l’autre Lui, violent, dominateur et exploiteur. Les voilà l’un et l’autre figés dans leur opposition. Comment jamais sortir de ce piège ?
P 68 et 69 : On peut se demander si la notion simplificatrice et unificatrice de « domination masculine » n’est pas un concept obstacle. Autre nom d’une altérité radicale, il servirait à éviter de penser la complexité, l’historicité et l’évolution du rapport des sexes. Ce concept « attrape-tout », en enfermant hommes et femmes dans deux camps opposés, ferme la porte à tout espoir de comprendre leur influence réciproque et de mesurer leur commune appartenance à l’humanité.
P 102 : La culture et l’environnement semblent être de meilleurs indicateurs de la délinquance juvénile que le sexe.
P 104 : L’enquête de l’Enveff porte exclusivement sur les violences faites aux femmes, et nul n’a encore eu l’idée de poser des questions similaires aux hommes. Faute de questions, pas de réponses, et le silence total entretenu sur le phénomène rend encore plus difficile la plainte des « hommes maltraités ».
P 105 : Dans l’inconscient collectif, et pas seulement féministe, les hommes agressent et abusent de leur force sur les plus faibles ou les protègent. On ne les imagine jamais du côté des victimes, ni les femmes du côté des bourreaux et des persécuteurs.
P 142 : La bonne sexualité ne se conçoit en fait que dans l’amour, ou le désir partagé. La sexualité pulsionnelle, qui ignore le sentiment, est hors la loi, amorale et donc à combattre.
P 168 : La sexualité n’obéit pas à la seule conscience ni aux impératifs moraux tels qu’on les définit à une époque ou à une autre. Elle ne se confond pas non plus avec la citoyenneté. Elle appartient à un tout autre monde, fantasmatique, égoïste et inconscient.
P 172 : La ressemblance des sexes est au bout du chemin et certainement pas au début.
P 181 : Les deux sexes se posent en victimes l’un de l’autre, à ceci près que les femmes parlent haut et fort et que les hommes murmurent.
P 186 : N’aurait-il pas mieux valu lutter pied à pied dans tous les domaines, privé, public et professionnel, entachés d’inégalité ? Autrement dit, descendre dans la rue pour dénoncer ces injustices plutôt que de faire le procès des hommes ?
Résumé indicatif et informatif :
Livre grand public et non ou peu scientifique, nous pourrions toutefois y voir une approche sociologique et/ou psychosociologique.
Dans son introduction, « le tournant des années 90 », E.B rappelle quelques évolutions récentes qui ont permis à la femme de s’affranchir, de gagner de l’indépendance, du pouvoir signant la fin du patriarcat.
Toutefois, loin d’obtenir enfin une égalité de fait, la lutte de pouvoir continue et en réponse un certains « victimisme » s’est installé, avec ses avantages multiples.
Toujours plus de victimisation et de pénalisation détourne des combats plus constructifs à mener, voire augmente le risque de retour des vieux stéréotypes attachés à la condition féminine.
Quatre chapitres et une sobre quantité de sous-titres, d’abord pour décrire l’amalgame par analogie et généralisation avec comme objectif la mise en accusation de l’autre sexe notamment face au « martyrologue féminin » dans le domaine sexuel.(auteures américaines). Puis la juste évolution pénale en France pour réprimer les agressions sexuelles (loi 1980 / viol, 1992 et 2002 sur le harcèlement sexuel et moral).
Par contre une loi européenne – p 31 – applicable en Juillet 2005, défini de manière très large et floue le harcèlement sexuel qui permettrait des interprétation et accusations abusives (cf. phrase – clef) en décalage avec « une sorte de prurit d’exhibition » p 147. Et d’analyser p 148 la complexité d’un consentement sexuel entre le « non = non, le oui = non et le oui = oui, le non = oui » ! et la difficulté d’accorder tête et ses peurs, conditionnement… cœur et corps pulsionnels.
La parade pourrait être un contrat rédigé, attestant la transparence du consentement. p 152 : l’auteur parle de sexe « légale » supprimant les non-dits, la spontanéité… oubliant que le consentement amoureux se joue souvent dans le « peut-être », le oui et le non à la fois.
L’inconscient n’a plus ça place dans cette exigence de transparence faisant fi des refoulements conditionnés, de la culture, religion, culpabilité…
Et de conclure sur la prostitution sous « contrat » avec un corps « objet » de transaction : esclavage – aliénation ou libre choix ?
L’enquête de l’ENVEFF – 2001 – 6970 femmes interrogés par téléphone – est passée au crible : médiatisée, elle avait eu un impact important sur la perception du public des violences conjugales. 2 chercheurs, par ailleurs, se s’ont livré à un démontage de cette enquête : Lacub juriste et Le BRAS démographe, dans un article de l’express – Avril 2003 – : « … ses auteurs ont sacrifié la rigueur au militantisme, dans le but plus ou moins conscient de légitimer une idéologie « victimiste ».
Après un hommage – p 40 – au féministe qui ont permis de briser le silence autour du viol malgré sa sous évaluation dans tous les pays, conteste les estimations Américaines dans lesquelles on peut noter que seul l’inceste masculin est évalué. Leur objectif : « plus le pourcentage de viols était haut, plus on pouvait promouvoir l’idée d’une culture U.S sexiste et misogyne et d’un mâle U.S particulièrement violent » selon E.B qui ajoute : « c’est la principe même de virilité qui est mis en accusation » – cf. son analyse du concept de harcèlement sexuel –
Ce n’est plus l’abus qui est condamné mais l’homme, inconditionnellement.
Suit une analyse de différents féminismes et de citer quelques auteurs : S. de Beauvoir, F. Héritier, A. Fonque… notamment à propos de la question du risque de disparition des genres à force de mélanger réduction des inégalités et droit à la différence (à définir !?)
Partant du constat – p 63 – que les sociologues et anthropologues s’accordent sur la domination masculine dont Fo de Singly et ses formes modernes, elle tente d’en chercher l’origine et les solutions malgré un aspect « transculturel et éternel » : l’homme peut-il se sentir puissant sans être sexiste ? Et de conclure sur les évolutions et les multiples masculinités – p 68 –
La pédophilie cristallise un peu plus le « dualisme oppositionnel » et manichéisme – Femme du côté du Bien et Homme du côté du Mal – car elle est médiatisée et réprimée sous sa forme masculine ; enfant victime justifie les femmes à prendre la défense de « leurs » enfants, voire à revendiquer, sous couvert du droit à la différence, à une différence des droits en rapport avec leurs qualités spécifiques – MLF, M. SINEAU, S. VEIL, M. AUBRY, E. GUIGOU… – qui « trace en creux un portrait des hommes caricatural ».
Et de conclure sur le et sexisme par des statistiques jetant le doute sur ces qualités féminines opposées aux vices et pulsions de mauvais père : qui s’occupe beaucoup des enfants – 83 800 en danger (quels critères !?…) – et des vieux – 800 000 maltraités –
Abordant les violences conjugales, E.B s’étonne que les victimes n’échappent pas ou plus vite à leur bourreau, la raison économique étant peu probable puisque toutes les C.S.P sont concernés.
Outre le côté tabou du sujet relatif à la violence féminine, il semble toujours justifié. Même l’ouvrage collectif « de la violence et des femmes » 1997 « ne traite pas du sujet en soi et pour soi ». Devant les archives de la révolution qui suscitent une impression très forte de violence féminines, D. Godineau s’emploie à en diminuer la portée ; et comme souvent quand on est auteur d’un acte peu glorieux, on se cache derrière le « comme les autres », « tout le monde »…
Et même si la violence féminine est difficile à penser, E.B l’aborde de front p 89 en distinguant violence historique – génocides, camps d’extermination… (actes, dénonciations, incitations…) – et au quotidien, par sadisme, intérêt : tuer, humilier, torturer…aliéner, rejeter, abandonner, dominer, frapper…
Après quelques exemples de violences de droit commun médiatisées en France notamment de la part d’adolescentes et particulièrement contre d’autres filles ou femmes, et un constat d’aggravation dans d’autres pays anglo-saxons, d’une part, il est difficile là aussi de dépasser une certaine idéalisation, celle de l’innocence infantile, d’autre part, selon un pourcentage canadien, la culture et l’environnement semblent plus déterminants que le sexe. Manière de revendiquer l’égalité dans l’agressivité ?
La violence conjugale ne s’énonce qu’au féminin ; pas de statistique, pas de plainte, pas de doute : dans ce cas, il n’y a que des femmes victimes avec tout un dispositif d’écoute, d’aide et de répression des hommes violents.
Pourtant, E.B cite des statistiques allemandes, des témoignages. Un homme battu subi la même humiliation désintégrante plus la honte ; s’il se défend il sait qu’il y a un risque de représailles ; il peut, comme la femme, être « attaché » (aliéné) à sa persécutrice ou être prisonnier du stéréotype de la virilité (comme la femme de celui de victime).
Cld E.B affirme que « la violence à l’humanité », on ne sait si elle parle d’une caractéristique naturelle ou d’un état de fait. Les tensions, conflits, souffrances lui semblent inévitables et une violence verbale « l’homme et la femme seraient au – à armes égales » (quoique ?…) ne doit pas être assimilable à la violence physique : une bonne engueulade ferait soupape. (avec un risque de faire monter la tension ?)
Dans la lutte pour les pouvoirs, l’autonomie des femmes ayant des ressources propres n’exclue pas une dépendance plus invisible. Selon E.B, le pouvoir psycho n’est pas d’essence masculine : selon les couples c’est lui ou elle qui domine ou est dépendant : ne serait-ce pas les 2 (cf. collusion) ? et de regretter que l’enquête de l’ENVEFF n’ait pas interrogé le même échantillon, soit 700 hommes par le chantage affectif, les insultes et les pressions psycho, donnant une autre idée des violences conjugales et faire cesser l’absurdité d’une vision des hommes seuls jaloux, tyranniques…
« Faire un enfant dans le dos » ou contre un refus explicite est un abus de pouvoir : pas de statistique. C’est contradictoire avec l’attente que les pères s’impliquent.
Reconnaître l’ des violences féminines ne minimiserait pas celle des hommes et contribuerait à « renoncer à une vision angélique des femmes qui fait pièce à la diabolisation des hommes ».
Accusation à tort d’abus sexuel, instrumentalisation des enfants, proxénétisme féminin… autant d’expressions de la violence et du pouvoir des femmes qui contredisent une humanité qui serait coupée en deux : les femmes victimes de l’oppression et innocentes, de l’autre les bourreaux tout-puissant.
Comme l’affirment certaines féministes, la sexualité masculine serait-elle à la racine du mal – p 113 –
Le champ de la sexualité féminine est jalonné de contradictions et de clans opposés : liberté – banalisation / socialisation – dignité, affranchissement / renforcement du joug masculin – stéréotypes moralisateurs / soi-disant libérés – homme prédateur-égoïste jouisseur / recherche d’amour… redéfinition des pourcentages homme / homme et libertés réciproques en sont les enjeux.
Une « Cacophonie sexuel » se substituerait à des siècles de refoulement collectif et de frustrations individuel : est-ce un simple changement de normes, une obéissance à de nouveaux diktats ?
Les quelques changements dans les comportements évalués par des enquêtes statistiques – SIMON, SPIRA / BAJOS, MOSSUZ – IAVAU – ne convainquant pas d’une réelle libération sexuelle : plus de stimulation – excitation pornographique et fantasmes ne dénouent pas les complexes psycho-corporels, émotionnels et relationnel sous une pseudo diversité des relations à la sexualité et malgré une évolution réelle de la conception plus égalitaire de la relation.
Les pratiques sexuelles extrêmes seraient encore marginales même s’il y a une tentative de les banaliser, de « dédiaboliser ». cf. rechercher ethnographique de Danièl Welzer-Lang.
Par contre, les régimes draconiens, chirurgies esthétiques sont à la mode, obsessions de la performance et de l’apparence « démultipliées par les images érotico-pornographiques qui nous assaillent ». Le corps-objet torturé est finalement désinvesti dans sa globalité au profit d’un morcellement et instrumentalisation.
La « déculpabilisation du plaisir féminin » semble ouvrir un nouveau marché pour les sex-shops et la « Redoute » de « sex-boys ludiques mais efficaces ».
Face à ces jouissances féminines solitaires et mécaniques, on peut imaginer une surenchère de la panoplie chimique, parade à l’angoisse masculine de l’impuissance.
Pour conclure, p 138 quelques questions : … « libération des tabous ou tyrannie du fantasme… épanouissement ou solitude et misère sexuelle »… ?
Dans le chapitre suivant E.B ouvre le débat de la « bonne sexualité » (amour ou désir partagé) face au pulsionnel, amoral, sexe licite et illicite. Avec en arrière plan la domination masculine et l’argent, la prostitution y compris masculine, également ce qu’on peut appeler « la prostitution privée ». Cette dernière ne se cache-t-elle pas derrière la fustigation de celle de la rue ?
Commentaire :
Dans mon analyse du consentement à l’acte sexuel – voir aussi p x ci-avant – avec ce oui qui veut dire non – « céder n’est pas consentir » – et ce non qui veut dire oui : « il n’est pas rare que la femme oppose un refus symbolique et une résistance pour la forme afin de mieux signifier son assentiment « E. FASSIN ; dans son analyse manquent 2 aspects :
– les motifs pathologiques – névroses, traumatismes… – qui inhibent la sexualité. E.B. raisonne comme si chaque individu disposait pleinement de leur libre choix, comme si celui-ci était uniquement issu d’une activité intellectuelle-cérébrale.
– comme dans les quelques études que j’ai pu connaître, seule la sexualité des personnes qui ont… une sexualité est étudiée, comme si tous les individus en avait une. Manque donc une évaluation du nombre d’abstinents volontaires et involontaires un des « comportements » sexuels et les différents motifs.
Enfin chez beaucoup de « spécialistes » interrogés sur le thème de la sexualité notamment par des magazines comme « psychologies »… , il est récurrent de ressentir dans leurs propos une connotation ou référence à la morale, du jugement sur les comportements – des hommes envers les femmes particulièrement -. Ce n’est pas le cas dans Fausse route, même si elle ne consacre que quelques pages à l’aspect sexuel des relations hommes / femmes, ni le cas d’études plus scientifiques (REICH…) et enquêtes statistiques (rapport SIMON 1972, « les comportements sexuels en France » 1993…)
Oubliant qu’il existe déjà une « pornographie féminine » à base de romans-photos, de registre sentimental, E.B cite une réalisatrice danoise qui tente une pornographie calquée en partie sur celle destiné aux homme – du registre corporel – et adaptée aux femmes, réalisée par et pour la Femme.
La sexualité masculine est mise sur la sellette par différents féminismes, du rejet total de l’hétérosexualité (essentialisme) à une acceptation de l’essence masculine mais assortie d’une critique encore si radical que peu d’homme peuvent échapper à l’anathème (culturalisme – Mackimon et Dorkui notamment). Le sexe est vécu comme une agression : … »le viol est le paradigme de l’hétérosexualité »… ! Traduction de l’idée que la sexualité et la pénétration sont le fondement de l’oppression des femmes par les hommes.
L’enjeu semble, pour certaines, de « féminiser » la sexualité masculine niant au passage la violence des pulsions féminines, en l’éduquant… E.B rappelle que le pôle pulsionnel n’est jamais totalement domestiqué ou réductible à un modèle féminin de douceur et de non domination.
L’enfeu peut-être encore plus radical ; castrer symboliquement les hommes en dénigrant ses qualités spécifiques : courage et prise de risques, force, conquête… Double erreur pour E.B :
– ces caractéristiques ne sont pas réservées aux seuls hommes
– nombre de féministe – 1970-80 – ont échoué dans une tentative d’éducation asexuée : il ne peut y avoir de rencontre qu’entre 2 pôles et identités sexuelles.
« La déconstruction de la masculinité en vue de l’alignement sur la féminité traditionnelle (?…) est une erreur » p 175.
La plupart des hommes et des femmes ont envie de vivre ensemble et de mieux vivre ; cette envie est subordonnée à l’égalité ou à l’amélioration de la relation ?
Ces 15 dernières années, le credo du féminisme dominant est : « les femmes sont toujours victimes des hommes et appellent une protection particulière ».
Le rapport homme / femmes peut différer selon les classes sociales et les générations : attention à l’amalgame.
E.B prend acte d’une montée en puissance de l’idéologie féministe, notamment au niveau législatif ; grâce aux médias et au silence des hommes déstabilisés par un pouvoir moral et culpabilisateur considérable.
L’homme conserve toutefois un pouvoir clé : l’économique et financier – cf. sous représentation femmes aux C.A, postes d’encadrement.
Le foulard islamique est une atteinte à l’égalité des sexes, à l’universalisme et à la laïcité : analyse de sa signification : femme non objet de désir, inabordable…
L’association « ni putes si soumises » dénonce une régression du statut des femmes dans les quartiers fermés aux féminisme avec une augmentation des violences à leur égard : mariage forcé… et interdits de vivre sa féminité, d’études… la République à abandonné les quartiers en grande difficulté en cédant aux pressions communautaristes.
La déclaration des droits de l’homme comme la constitution furent malmenées avec une inscription du dualisme sexuel basés sur les différences biologiques. L’état maternel (être) opposé au comportement paternel (faire). Différences qui enferment dans l’opposition et la femme dans un destin obligatoire sous peine d’anormalité ou d’être suspectée de se faire une place dans le monde masculin.
Ce différentialisme sexuel – est relatif : il y a plus de différence entre individus homme ou femme selon leur appartenance à un CSP – est dangereux car risque de réactualiser la spécialisation stéréotypés des rôles combattue depuis 30 ans.
Evoquer l’instinct maternel relègue le père à assumer au seul devoir moral d’éducation et met la femme dans des revendications contradictoires.
L’analyse de cet instinct maternel version biologique et psychologique spontané met à mal certaines évidences et débouche (à peine explicitement) sur l’émotion à la base d’un lien d’Amour.
E.B juge la pression trop forte et culpabilisante subie par les mères fortement encouragées à allaiter.
Avant de critiquer l’A.P.E qui provoque le retour des mères (les plus démunies) au foyer, avec les difficultés de retour à l’emploi, la dépendance au compagnon et les inconvénients du temps partiel.
Commentaire :
Elle ne voit cependant que l’aspect précarité de cette situation, non les avantages ou l’autodétermination des femmes aptes à décréter en concertation avec le conjoint (?) ce qui est bon pour elle et leur famille…
Et de critiquer E.Antier qui encourage explicitement les mères à se consacrer à leurs enfants avant d’envisager la poursuite d’une carrière professionnelle ; ça arrangerait les hommes censés assurer les tâches ménagères – à qui on demande aussi d’être performant dans leur rôle économique et protecteur -.
Plus de crèches et de possibilités de garde des enfants comme E.B le propose au nom de la parité.
Commentaire et Conclusion :
E.B déclarait à l’express : « ce n’est pas si facile d’aller contre l’idéologie dominante ».
Après 30 ans de militantisme au MLF, elle s’insurge dans « Fausse route » contre ses dérives : avec des aller-retour entre les limites ou excès de certaines idéologies féminismes – victimiste par exemple – et un juste combat pour l’égalité et le respect de la femme, E.B réussit à s’affranchir de ses réflexes et militant pour proposer un juste regard né de la pluralité des militances : parfois elle se perd dans quelque contradiction ou opinion difficile à partager.
En effet, elle s’est exposée à la critique, courageusement, car en connaissance de cause très certainement : elle n’a d’ailleurs pas échappé à l’attaque de quelques-un(e)s qui se sont exprimés sur internet ou journaux.
• Maya Surdut : Badinter est vraiment une grande bourgeoise et le monde ne l’intéresse pas. Elle tombe à point nommé pour alimenter les régressions actuelles : contre celles qui se battent, elle déverse des pelletés d’ordures.
• Muriel Bordogna : Pour qui a-t-elle écrit ce livre ? Pour elle, (je ne le réprouve pas) pour avoir une conversation entre copines des beaux quartiers à l’heure du thé ? Tout est loin de mon quotidien et des luttes actuelles. Je n’ai pas trouvé de piste de réflexion, donc je trouve ce livre un peu cher…
• Clémentine Autain : Mais ce livre est tellement écrit contre les féministes qu’il bloque tout débat.
• Eric Fassin : Fausse route s’avère d’un antiféminisme d’autant plus efficace qu’il se réclame du féminisme.
• Caroline Fourest : Ce livre ne serait pas totalement inintéressant s’il n’était pas aussi confus. A aucun moment, il ne dit clairement à quel féminisme il s’adresse. S’il s’agit de critiquer un féminisme victimisant, essentialiste (1) et puritain et de pourfendre une certaine gauche dont la lecture du féminisme serait minimaliste, non radicale, alors nous sommes d’accord. Mais s’il s’agit de laisser croire que lutter contre les violences conjugales, le harcèlement sexuel et pour la redéfinition des sexes est faire preuve d’un abominable féminisme américain, qui risque de traumatiser les hommes à force de vouloir redéfinir la sexualité, je ne suis plus certaine de cerner l’objectif politique… Si ce n’est de fournir une caution inespérée aux anti-féministes. Malheureusement, je crains que cet aspect explique le succès actuel du livre.
• Josette Rome-Chastanet : Pamphlet… Badinter affleure ces questions, elle ne les résout pas.
Parité, égalité, différence des sexes, unisexe indifférenciation et différentialisme, essentialisme… : il n’est pas toujours facile de s’y retrouver et la réflexion psychosociologique se perd quelquefois un peu dans les tribulations politiques partisanes.
L’analyse des différents discours féministes fait quelques fois l’impasse d’un approfondissement scientif des sujets en cause. Le débat sur la parité, les rôles des hommes et des femmes tel qu’E.B le mène me semble bien spécifique au monde industriel et au mode de vie citadin : lorsque 60-70 % de la population était rurale, cette répartition d’une partie des tâches basée sur la force physique requise pour certains efforts se faisait naturellement. On peut encore facilement le constater aujourd’hui dans les quelques femmes existantes où il y a et une division des tâches et une coresponsabilité sur certains points : direction – gestion…